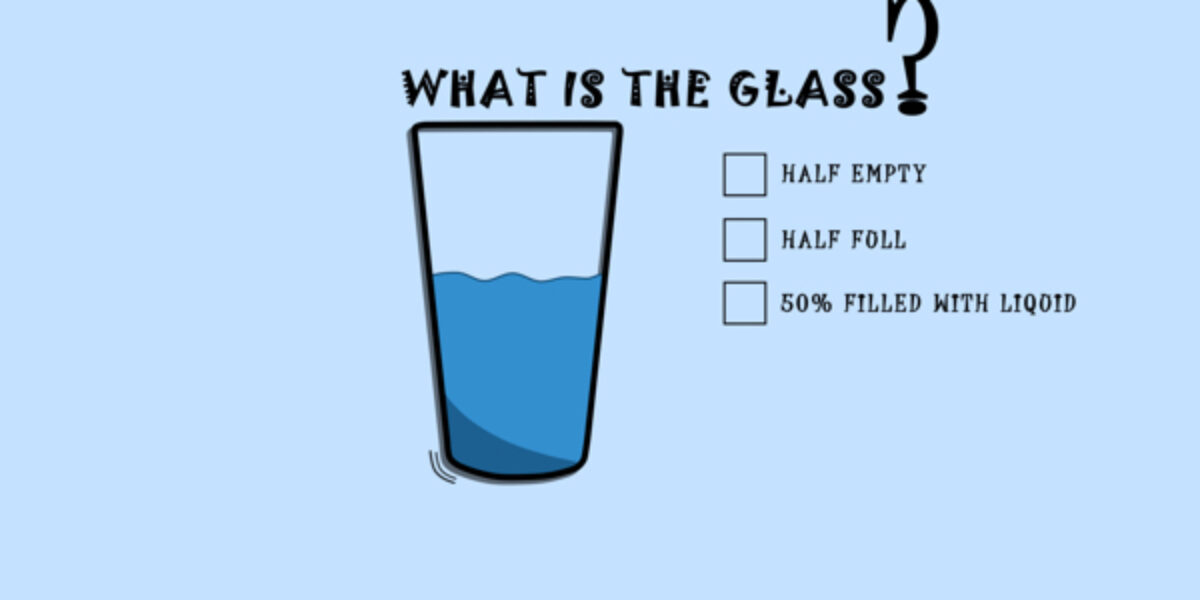Pour ce dernier article estival je vous propose de chercher (et trouver) plus de bonheur. Je viens de lire le livre de Tal Ben Sharar « The Pursuit of Perfect »[1], qui illustre bien comment notre aspiration à la perfection est à la fois un moteur qui nous pousse à toujours nous améliorer, et une source de stress et d’émotions négatives, qui nous sont nocives.
Il distingue le profil du Perfectionniste de celui qu’il définit comme l’Optimaliste, selon le tableau comparatif suivant :
[1] Le livre traduit en français qui correspond le plus à l’original américain est « L’apprentissage de l’imperfection » écrit avec Fabrice Midal, ed Pocket
| Perfectionniste | Optimaliste |
| Il a peur et rejette l’échec qu’il considère comme inacceptable puisqu’il ne correspond pas au monde idéal que le Perfectionniste imagine pour lui et les situations qu’il vit. Il est donc très critique envers lui-même et les autres quand le risque d’échec se présente. Il est toujours sur la défensive. | Il voit l’échec comme source d’apprentissage. Il essaie de l’éviter mais une fois que l’échec arrive, il le transforme en quelque chose de positif. L’échec fait partie de la vie. Il accepte d’en parler afin d’en tirer le meilleur parti. |
| Il rejette les émotions négatives comme étant inacceptables pour lui-même et pour les autres | Il accepte les émotions négatives comme faisant partie de la vie. |
| Il rejette le succès, il est incapable de le savourer car il voit toujours le « petit défaut » qu’il aurait pu éviter et raisonne avec les « et si j’avais fait ceci et cela… » | Il considère que le succès fait partie de la vie autant que l’échec. |
| Il rejette la réalité car il vit toujours dans un monde idéal (et donc inatteignable). | Il accepte la réalité car il vit dans le monde réel avec ses imperfections, ses aléas, ses périodes positives et ses périodes négatives. |
| Pour lui le but est plus important que le voyage pour l’atteindre et toutes ses actions et énergies doivent viser l’objectif final coûte que coûte. Les incidents de voyage sont vus comme des obstacles et non pas comme une partie de tout voyage. | Le voyage pour lui est aussi important que le but et il accepte les déviations de l’objectif qu’il considère aussi riches pour l’apprentissage que l’objectif lui-même |
Tal Ben Shahar a appelé ce profil Optimaliste pour le distinguer de l’optimiste. L’optimiste voit un peu naïvement la vie en rose, alors que l’Optimaliste sait faire face à la réalité qu’elle soit positive ou négative.
Bien évidemment personne n’est à 100% Optimaliste ou Perfectionniste et nous avons tous une partie de l’un et de l’autre. Le pourcentage de l’un ou de l’autre change aussi en fonction des phases de la vie. Souvent l’expérience et les inévitables échecs de la vie nous confèrent une certaine sagesse qui nous fait accepter la vie telle qu’elle est.
Voici donc ma question : Puisqu’ il est évident que l’Optimaliste vit une vie beaucoup plus heureuse que le Perfectionniste, pourquoi y-a-t-il autant de perfectionnistes au travail ? Je vois autour de moi des managers qui n’acceptent pas les erreurs de leurs collaborateurs, les obligeant à cacher ces erreurs, qui, par conséquent, se répètent indéfiniment.
Le problème est bien là : dans les environnements à tendance Perfectionniste, il est plus difficile d’apprendre quelque chose des erreurs commises puisque les gens n’en parlent pas avec la conséquence que l’erreur se répète. Si l’on n’accepte pas les erreurs comme faisant partie de la vie, il est évident qu’il est difficile de les partager avec les autres.
Les erreurs médicales étant la troisième cause de décès dans les hôpitaux américains, certaines institutions de santé ont rédigé des rapports pour comprendre l’origine du phénomène et essayer d’en diminuer les effets. La raison principale de ces erreurs est la peur des poursuites judiciaires de la part des patients. Par conséquent, les infirmières et les médecins considèrent les erreurs comme un tabou dont il ne faut surtout parler ni entre le personnel médical ni avec les patients.
Or, différentes études[2] ont prouvé que là où l’erreur était admise comme faisant partie de la vie de l’hôpital, les infirmières en parlaient entre elles, ainsi que les médecins, pour trouver des solutions, ce qui a réduit la mortalité due aux erreurs répétées. De plus, le fait que le personnel médical partage les causes des erreurs avec les familles des patients a aussi réduit le taux des plaintes et les montants des dommages-intérêts demandés.
Le partage de l’erreur est donc la clé principale pour en trouver la solution et aussi pour la diffuser afin que l’erreur ne se répète plus au sein d’une organisation.
Depuis notre enfance, nous sommes éduqués à faire de notre mieux et les écoles deviennent de plus en plus compétitives. Dès leur plus jeune âge les enfants apprennent que réussir est un DEVOIR, qu’il faut avoir de bonnes, et même d’excellentes, notes pour entrer dans telle ou telle école de prestige qui à son tour ouvrira les portes aux meilleures universités, donc aux chances de trouver le meilleur travail possible… Dans tout ça, comment l’enfant, l’adolescent, l’étudiant et le jeune qui entre dans le monde du travail peut-il trouver le temps pour apprendre de ses erreurs ? Si les erreurs ne sont pas admises dès la plus jeune enfance, comment le jeune adulte peut-il apprendre à les partager pour les résoudre avec les autres ?
Etre Optimaliste ne veut pas dire ne pas être ambitieux ni renoncer à faire toujours mieux. Les Optimalistes vivent beaucoup mieux et apprennent plus vite et avec moins de souffrance puisque l’erreur fait partie de leur vie comme de la vie en général. L’Optimaliste sait aussi que l’erreur est la première source d’apprentissage. Rappelons-nous combien de fois un enfant tombe avant d’apprendre à marcher ! Et pensons à la découverte de la pénicilline qui a sauvé des millions de vies humaines, et qui est née d’une erreur. En effet, en 1928, le docteur Fleming en rentrant des vacances, découvrit dans ses boîtes de culture de staphylocoques une moisissure qui avait poussé pendant son absence et qui est devenue ensuite la miraculeuse pénicilline, utilisée pour soigner les infections.
Il a été aussi prouvé que les Optimalistes vivent bien mieux que les Perfectionnistes car ils savent savourer les succès et les partager joyeusement avec leur entourage.
Après la lecture de cet article, avez-vous encore des doutes ? Je vous invite à profiter de l’été pour penser à votre bonheur et augmenter le pourcentage d’Optimaliste qui est en vous !
[2] Voir par exemple les études citées dans cet article du New York Times « When doctors admit their mistake » 19 août 2010, écrit par Pauline W. Chen. ; l’article « Error reporting and disclosure » de Zane Robinson Wolf et Rhonda G ; Hughes http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2652/